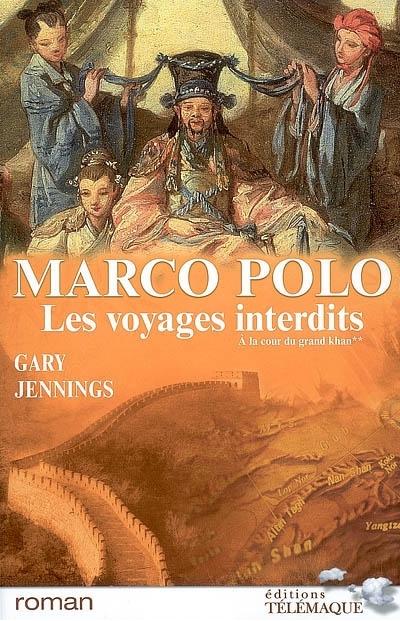![Marco Polo]()
Marco Polo
dose de ce qui ressemblait à de la sciure.
— Tsampa, annonça-t-il.
Tandis que je contemplais, abasourdi, ce brouet avec
le dégoût qu’on imagine, il me montra comment il convenait de le consommer. Il
trempa ses doigts sales dans mon bol et malaxa la sciure et le beurre jusqu’à
obtenir une pâte semblable à de la cire molle qui finit par absorber tout le
liquide qu’il contenait. Ensuite, avant que je puisse bouger pour l’éviter, il
préleva une boulette de cet amas tiède et crasseux, et le fourra dans ma
bouche.
— Tsampa, confirma-t-il.
Je pus alors reconnaître, derrière l’amertume du thé
vert et le goût rance du beurre de yack qui avait l’odeur du fromage, que ce
qui semblait être de la sciure était de la farine d’orge. J’ignore comment
j’aurais réussi à avaler cette bouchée s’il n’était survenu un événement qui me
poussa à le faire séance tenante. Le feu de camp émit brusquement, en effet, un
incroyable bang ! et envoya dans l’obscurité un soudain bouquet
d’étincelles, qui me fit engloutir d’un coup le contenu de ma bouche (et
l’effet fut le même sur mes deux soldats d’escorte), tandis que le bruit
résonnait dans les montagnes. Deux choses me vinrent alors à l’esprit. La
première fut l’affreuse pensée que l’une des boules de cuivre que nous
transportions avait trouvé le moyen de tomber dans le feu ; la seconde fut
la réminiscence de la fameuse phrase : « Je surgirai lorsque tu t’y
attendras le moins. »
Mais les hommes des montagnes, qui n’en pouvaient plus
de rire en constatant notre saisissement, nous firent des gestes d’apaisement
avant de nous expliquer ce qui venait de se produire. Saisissant l’une des
tiges de bambou et la pointant sur le feu, ils se mirent à sauter à côté, en
découvrant les dents et en grondant d’un air farouche. C’était assez clair. La
montagne grouillait de tigres et de loups. Pour les maintenir à distance, on
avait coutume de jeter dans les flammes, de temps à autre, une portion de bambou.
La chaleur avait pour effet de mettre sous pression sa sève, jusqu’à ce que la
vapeur fasse éclater celle-ci, un peu comme l’aurait fait une charge de poudre
inflammable, ce qui provoquait un énorme fracas. Je n’eus aucun doute sur sa
capacité à tenir les prédateurs en respect, et il me permit, somme toute,
d’avaler l’horrible mixture appelée tsampa.
Plus tard, je finis par m’y habituer ; je n’y
pris toutefois jamais plaisir, mais au moins ma répugnance avait disparu. Le
corps humain a besoin d’une autre nourriture que la viande ou le thé, et l’orge
était la seule céréale qui poussait en ces contrées. La tsampa était
fort nourrissante, bon marché et aisément transportable, ce qui était déjà
beaucoup. On pouvait la rendre plus appétissante en la saupoudrant de sucre, de
sel, à moins qu’on ne préférât l’assaisonner de vinaigre ou de sauce de
haricots fermentes. Je n’en devins pas pour autant aussi friand que les
autochtones, qui gardaient des boules de tsampa sous leurs vêtements
toute la journée et toute la nuit pour la déguster au petit matin saturée de
leur sueur salée ou en avaler un morceau dès qu’ils avaient un creux.
J’en appris aussi bien davantage au sujet de ce bambou
appelé ici zhu-gan. À Khanbalik, je ne l’avais considéré que comme un
agréable élément floral qui inspirait les peintures de Dame Chao ou du Maître
de la Peinture sans Contour. Dans ces régions, il constituait un objet
indispensable. Le zhu-gan poussait à l’état sauvage partout dans les
basses terres, de la frontière entre Sichuan et Yunnan aux zones tropicales de
Champa où il portait entre autres, suivant les dialectes locaux, les noms de banwu, de mambu. Il servait partout à bien d’autres usages que celui
d’effrayer les tigres.
Le zhu-gan ressemble à nos roseaux et à nos
joncs, du moins lorsqu’il en est encore au début de sa croissance et que son
diamètre n’excède pas la largeur d’un doigt : il ne s’en différencie que
par ses nœuds placés à intervalles réguliers telles des jointures, qui forment
comme de petits murs dans sa structure interne qui délimitent des compartiments
séparés. Pour éloigner les bêtes sauvages, il suffit de jeter au feu une
section de bambou, entre deux nœuds intacts aux extrémités. Pour d’autres
usages, on perce ces cloisons de façon à transformer le bambou en un long tube
creux. Tant que
Weitere Kostenlose Bücher