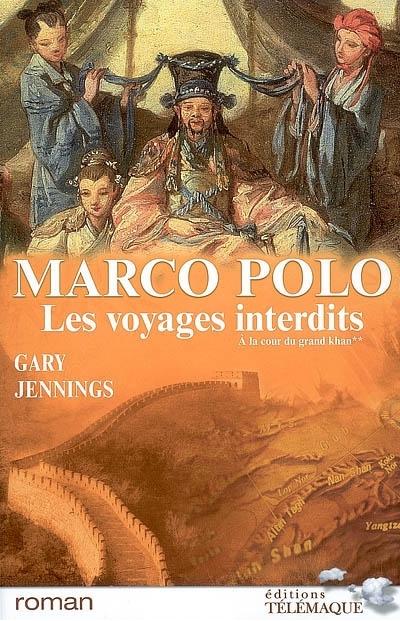![Marco Polo]()
Marco Polo
hommes
ou femmes, portaient tous des vêtements informes : sur la tête, un chapeau
qui ressemblait à une cosse de haricot, sur le corps, des robes, des écharpes
et des châles empilés en couches successives des épaules jusqu’aux pieds, et à
ces derniers de lourdes et peu élégantes bottes aux pointes relevées. Tous ces
habits étaient rayés de bandes de deux couleurs, chaque village ayant les
siennes, de sorte qu’un « étranger » venant du village situé un peu
plus bas sur la route pouvait aisément être reconnu comme tel. Les couleurs
étaient toujours sombres, celles de Chieh-chieh, par exemple, étaient le marron
et le gris, pour que la crasse ne s’y voie pas trop. Dans ces villages de
montagne, ce type de tenue permettait de se fondre dans le paysage, ce qui
pouvait avoir son utilité, pour la chasse ou pour se dissimuler. Mais ici, sur
ce brillant environnement de bambou vert et or, elle heurtait le regard.
Les autochtones des deux sexes portaient sensiblement
le même accoutrement et arboraient le même visage imberbe aux traits plats et
au teint brun rouge. Il leur fallait donc – ne serait-ce que pour s’y
reconnaître eux-mêmes, pensai-je – une marque distinctive visible. Aussi les
femmes portaient-elles des bandes verticales, celles de leurs homologues
masculins étant horizontales. Pour l’étranger que j’étais, qui ignorais cette
subtilité vestimentaire, le seul moyen de les identifier était d’attendre
qu’ils ôtent leur couvre-chef en forme de cosse. Les hommes arboraient
généralement un crâne rasé et un anneau d’or ou d’argent à l’oreille gauche,
tandis que la tête des femmes était hérissée d’une multitude de fines tresses,
au nombre, pour être précis, de cent huit, comme la quantité de livres du Kandjur, l’ouvrage sacré des bouddhistes qu’ils étaient tous.
Mon voyage n’ayant pas été éprouvant ce jour-là et la
beauté de ce village de bambou m’ayant apaisé, je me sentis d’humeur à
considérer avec curiosité les autres preuves de féminité que pouvait receler
cette demoiselle, sous ses piètres atours. Je notai qu’elle portait un
bijou : une chaîne pendue à son cou, à laquelle était suspendue une
tintinnabulante rangée de pièces d’argent. Pensant qu’il devait aussi y en
avoir cent huit, j’interrogeai le vieux Wu :
— Lorsque vous qualifiez cette femme de
« premier choix du village », vous faites allusion à sa richesse ou à
sa piété ?
— Ni l’un ni l’autre, commenta-t-il. Les pièces
que vous pouvez voir attestent seulement de l’attractivité de ses charmes.
— Vraiment ? fis-je, la fixant du regard.
Si son collier était en effet attrayant, il n’ajoutait
hélas pas grand-chose à son charme.
— Chez nous, précisa-t-il, c’est à la jeune fille
qui aura le plus d’amants : qu’ils soient de son village, de ceux des
environs, ou de passage, commerçant ou autre. Chacun de ceux avec lesquels elle
couche lui donne une pièce en souvenir. Aussi, celle qui, grâce à sa collection
de pièces, peut attester avoir attiré et satisfait le plus grand nombre
d’hommes est considérée comme prééminente.
— Vous voulez dire qu’elle est réprouvée et mise
à l’écart, je suppose ?
— Pas du tout, elle est mise en valeur, au
contraire ! Dès qu’elle sera en âge de se marier et de s’établir, elle
n’aura que l’embarras du choix parmi de nombreux prétendants désireux d’emporter
sa main.
— Laquelle demeurera sans doute, en l’occurrence,
la partie de son corps ayant le moins servi, persiflai-je, un tantinet
scandalisé. Dans les pays civilisés, un homme épouse justement une vierge,
sachant qu’elle n’aura appartenu à personne avant lui.
— Oui, c’est à peu près la seule chose qu’elle
est sûre d’apporter, d’ailleurs..., lâcha le vieux Wu, reniflant d’un air
méprisant. Ce que risque un tel homme, c’est tout au plus attraper un poisson
moins chaud que celui que tu as eu à dîner. Alors que celui qui épouse l’une de
nos femmes a d’abondantes preuves de son attrait, de son expérience et de ses
talents. Il obtient en même temps, et ce n’est pas négligeable, une assez
coquette dot en pièces d’argent. Et cette jeune femme serait des plus désireuse
d’ajouter une des tiennes à sa chaîne, n’en ayant encore jamais reçu de la part
d’un Ferenghi.
Je n’éprouvais aucune aversion de principe pour les
femmes non vierges, et
Weitere Kostenlose Bücher