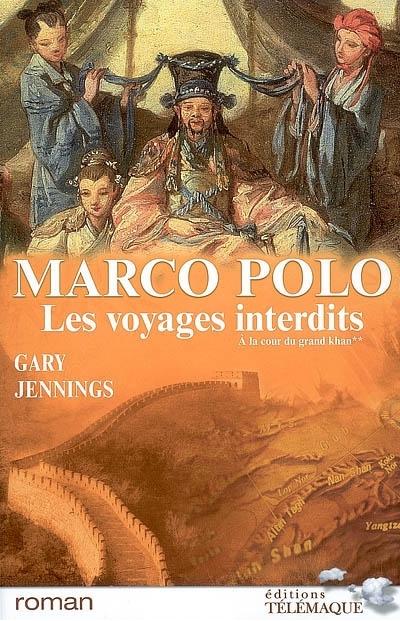![Marco Polo]()
Marco Polo
fallut
mettre à l’ancre fort loin en raison de l’étendue des marécages du delta, la
troisième près d’un petit archipel de sept îles, à Bombay, la dernière dans un
minable village de pêcheurs nommé Karachi.
Nous y trouvâmes de l’eau fraîche et en profitâmes
pour remplir nos réservoirs, car, de ce point, nous nous dirigeâmes de nouveau
plein ouest et, durant quelque deux mille li (environ trois cents farsakh, devrais-je dire, puisque nous étions proches de la Perse où cette mesure
était en vigueur), nous allions longer la côte brun foncé d’une terre brûlée
par le soleil, assoiffée, aride et déserte appelée le Béloutchistan. La vue de
ce rivage desséché ne fut égayée qu’occasionnellement par deux traits
particuliers à la région. Durant toute l’année, un vent du sud souffle depuis
la mer vers le Béloutchistan. Aussi, où que nous puissions observer un arbre,
il avait toujours la forme d’un arc courbé, incliné vers l’intérieur des
terres, comme un bras qui nous aurait invité à gagner le rivage. L’autre
particularité de cette côte était ses volcans de boue : de petites
collines en forme de cônes courtauds, faites de boue séchée, crachant de temps
à autre un jaillissement de terre brunâtre qui dégoulinait et cuisait doucement
au soleil dans l’attente d’un nouveau hoquet terreux. Difficile d’imaginer une
terre moins attrayante.
Après avoir longtemps longé cette côte désolée, nous
finîmes par entrer dans le détroit d’Ormuz qui nous mena dans la cité du même
nom ; je me trouvais donc en Perse. Ormuz était une ville immense et
affairée, si peuplée que certains de ses quartiers résidentiels s’étendaient du
centre urbain jusqu’aux îles situées en face. C’était aussi le port le plus
actif de Perse, véritable forêt de mâts et d’espars, tumultueuse de mille
bruits et incroyable par son mélange d’odeurs, lesquelles n’étaient pas toutes
agréables. Les bateaux étaient bien sûr pour la plupart des qurqur, des dhao et des felouques arabes, mais les plus gros avaient l’air de simples canots
ou prau à côté de nos vaisseaux massifs. On avait sans doute déjà vu ici
un chuan, mais sûrement pas une telle flotte qui envahissait à présent
les chenaux du port. Dès qu’un bateau pilote nous eut indiqué un point de
mouillage, nous fûmes entourés des skiffs, de chalands, de barges et de tout ce
que cette ville comptait de vendeurs, guides, souteneurs et mendiants des quais
qui nous hurlaient leurs sollicitations. Ce qui semblait être tout le reste de
la population d’Ormuz était rassemblé le long du quai, bouche bée ou jacassant
avec excitation. Cependant, nulle trace dans cette foule de ce à quoi nous nous
étions attendus : des nobles venus souhaiter la bienvenue à la future
ilkhatun.
— Curieux, murmura mon père. La nouvelle de notre
arrivée a pourtant dû courir le long de la côte. Et l’ilkhan Arghun doit être,
à l’heure qu’il est, impatient de nous voir paraître !
Tandis qu’il commandait le débarquement de toute la
compagnie et de ses bagages, je hélai une barque et, fendant la foule des
solliciteurs, fus le premier à mettre pied à quai. J’accostai un citoyen à
l’air intelligent et m’enquis de la situation. Puis je me fis sans délai
raccompagner à la rame jusqu’à notre bateau, où je fis mon rapport à mon père
et à l’envoyé Uladai, ainsi qu’à l’anxieuse Kukachin :
— Vous devriez peut-être suspendre le
débarquement jusqu’à ce que nous ayons tenu conférence. Je suis désolé d’être
le porteur de mauvaises nouvelles, mais l’ilkhan Arghun est mort d’une maladie,
il y a quelques mois [34] .
Dame Kukachin éclata en sanglots, aussi sincèrement
que si l’homme avait été son fiancé de longue date ou son mari bien-aimé.
Tandis que ses dames de compagnie l’entraînaient vers sa suite et que mon père
mâchonnait pensivement, Uladai s’exclama :
— Vakh ! Jeparie qu’Arghun est mort au moment précis où mes camarades émissaires
périssaient à Java. Nous aurions dû nous douter qu’un drame se préparait.
— Nous n’aurions de toute façon rien pu faire
pour l’empêcher, fit remarquer mon père. La question qui se pose à présent
est : que devons-nous faire de Kukachin ?
— Ma foi, dis-je, il n’y a plus d’Arghun pour
l’attendre, et l’on me dit que Ghazan, son fils, est encore trop jeune pour
Weitere Kostenlose Bücher