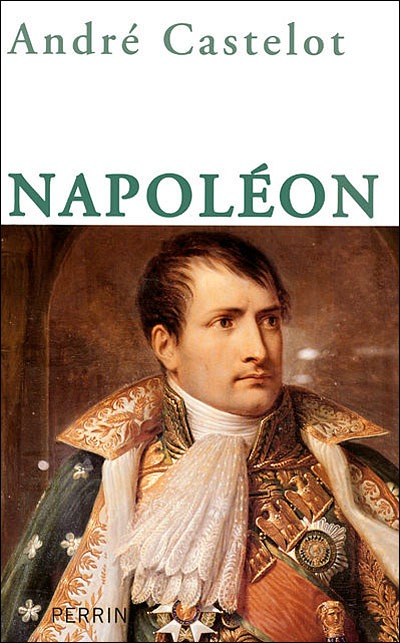![Napoléon]()
Napoléon
de Napoléon dans la péninsule italienne – même étendu sur une chaise longue – aurait mis le feu aux poudres. Et le chancelier laissera mourir son otage, en cachant à Marie-Louise, craignant qu’elle n’accoure à Vienne, la gravité de l’état de santé de son fils. Il approuvera son médecin – un accoucheur ! – qui soignera l’Aiglon pour une maladie de foie dont il n’était, d’ailleurs, pas plus atteint que le prisonnier de Sainte-Hélène...
Hors celui qui est maintenant devenu le duc de Reichstadt, hors les miséreux grognards en demi-solde qui se réunissent pour parler de leur idole, personne ne pense plus à Napoléon. Pas un seul grand serviteur de l’Empire dont il a fait la fortune n’essaye d’adresser le moindre mot au proscrit. Quant aux membres du clan – à l’exception de la chère Pauline – ils ne songent plus qu’à se faire oublier et à être tolérés par les nouveaux maîtres de l’Europe, ou bien à vivre, comme le roi Joseph, au Nouveau Monde, dans un exil doré...
Lui rêve souvent à sa grandeur passée et à ce qu’il est devenu aujourd’hui... Il a des insomnies et ne parvient plus à se rendormir : les souvenirs l’assaillent et l’accablent. Ses compagnons le voient un soir feuilleter rêveusement l’Almanach impérial, regarder les noms des dames du palais et parcourir la liste des membres de l’Institut, celle des rois vassaux et celle des préfets.
— C’était un bel empire, soupire-t-il avec émotion. J’avais quatre-vingt-trois millions d’êtres humains à gouverner, plus que la moitié de la population de l’Europe entière !
Et ne lui reste plus, aujourd’hui, qu’à se pencher sur le problème d’une vache mise à l’écurie, ne donnant qu’une pauvre bouteille de lait par jour et rompant, sans cesse, ses liens pour aller vagabonder dans le jardin... Un jour, il aperçoit les langes de la petite Montholon étalés sur l’herbe pour les faire sécher.
— Ah ! c’est trop bourgeois, trop petite ville, s’exclame-t-il.
Et il préfère regagner sa maison...
Il sait parfaitement tout ce qu’il a apporté au monde. Et ses compagnons l’entendent alors, d’une voix presque d’outre-tombe, prononcer sa défense :
— On aura beau retrancher, supprimer, mutiler, il sera difficile de me faire disparaître tout à fait. Un historien français sera obligé d’aborder l’Empire, et, s’il a du coeur, il faudra bien qu’il me restitue quelque chose, qu’il me fasse ma part, et sa tâche sera aisée, car les faits parlent, ils brillent comme le soleil... J’ai refermé le gouffre de l’anarchie et débrouillé le chaos... J’ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire... Sur quoi pourrait-on m’attaquer, qu’un historien ne puisse me défendre ?... Mon despotisme ? Mais il démontrera que la dictature était de toute nécessité. M’accusera-t-on d’avoir trop aimé la guerre ? Il montrera que j’ai toujours été attaqué. D’avoir voulu la monarchie universelle ? Il fera voir qu’elle ne fut que l’oeuvre fortuite des circonstances, que ce furent nos ennemis eux-mêmes qui m’y conduisirent pas à pas...
Souvent il a des accès de colère. Ce n’est là ni orgueil ni cruauté comme veulent le faire croire ses gardiens, mais la rage de voir à quel point il est tombé – et combien, souvent, on lui « manque », selon son expression. Il tyrannise son entourage. Lorsqu’il ne dort pas, il appelle en pleine nuit l’un de ses malheureux officiers – et ceux-ci doivent se présenter en uniforme, comme aux Tuileries – pour dicter une éternelle protestation adressée au monde ou une tout aussi éternelle explication de la bataille de Waterloo.
Mme de Montholon et Mme Bertrand ont bien du mal à donner un air de jeunesse à leurs toilettes emportées de Paris. Les deux jeunes femmes entendent le proscrit leur dire :
— Vous êtes mal coiffée. C’est de la Chine, cette robe-là ? Elle n’est pas belle !
Il se rend compte qu’il a été injuste et essaye de rattraper ses maladresses :
— À la bonne heure, dit-il à Mme Bertrand en la voyant entrer dans la salle à manger, voilà un buste de salon !
« La Montholon est toute rouge », note Gourgaud.
— Vous ne composez plus qu’une poignée au bout du monde, avait déclaré l’Empereur à ses compagnons, le matin du lundi premier janvier 1816 : votre consolation
Weitere Kostenlose Bücher