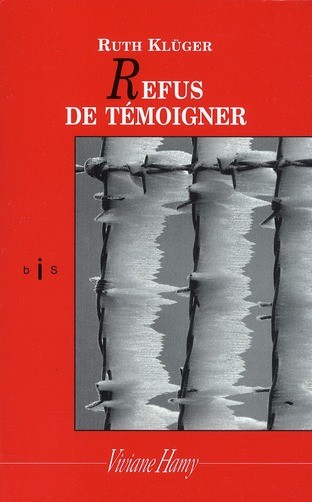![Refus de témoigner]()
Refus de témoigner
de leur goût du
dialogue, du jeu, de la plaisanterie cette surface de moins d’un kilomètre
carré de terre tchèque. Ce qui était bien, c’était notre manière de nous
affirmer. De telle sorte que je découvris pour la première fois ce que pouvait
être ce peuple, dont je pouvais, devais, voulais faire partie. Lorsque je me
pose aujourd’hui la question de savoir en quoi et jusqu’à quel point moi, qui
ne crois pas, je suis seulement juive, bien que ce soit une question à laquelle
on ne saurait répondre, entre plusieurs réponses possibles je trouve la suivante :
« Ça vient de Theresienstadt, c’est seulement là que je le suis devenue. »
J’ai haï Theresienstadt, ce bourbier, ce cloaque où on ne
pouvait pas tendre les bras sans se heurter à quelqu’un d’autre. Une
fourmilière qu’on écrasait. Lorsqu’on me présente quelqu’un qui a été à
Theresienstadt, j’ai honte de ce point commun, je m’empresse de dire que je n’y
suis pas restée jusqu’à la fin de la guerre, et j’interromps la conversation le
plus vite possible, pour me défendre de toute idée d’appartenance commune. Qui
a envie d’avoir été fourmi ? Même aux toilettes on n’était pas seul, parce
qu’il y avait toujours devant la porte quelqu’un qui avait besoin d’y aller d’urgence.
On vivait dans une grande étable. Les détenteurs du pouvoir, qui se montraient
de temps en temps, revêtus de leurs uniformes venaient vérifier que le bétail
ne tirait pas trop fort sur la corde. On avait l’impression d’être moins que
rien, et c’était bien le cas. Appartenir à un peuple impuissant, alternativement
prétentieux et autocritique jusqu’à la limite de la haine de soi. Ne posséder
pas d’autre langue que celle des détracteurs de ce peuple. N’avoir aucune
opportunité d’en apprendre une autre. Ne rien apprendre, ne rien pouvoir
entreprendre. Cet appauvrissement de la vie. La localité de Leitmeritz, où
avaient vécu les officiers du romancier Ferdinand von Saar, aussi éloignée de
nous que New York. Piétiner sur place, attendre que le temps passe, tout en
prenant de l’âge. Un provisoire qui ne veut pas finir. Devoir rester là : des
décennies plus tard, je suis sortie de Theresienstadt en voiture, c’était la
réalisation d’un vieux rêve.
Car quelque chose m’attirait à Theresienstadt, longtemps
après la guerre ; je voulais revoir les lieux. Theresienstadt est aujourd’hui
Terezin, une petite ville tchèque. Elle m’a semblé presque vide, par rapport à
la masse de gens qui y habitaient, si l’on peut dire habiter, à l’époque. Je
suis rentrée dans la caserne d’officiers où nous étions logées, L 414, j’ai
frappé à la porte. La dame qui m’a ouvert a tout à fait compris mon désir de
revoir la pièce où j’avais vécu avec trente autres petites filles. Notre ancien
dortoir était sa salle à manger, et elle n’était pas plus grande, plutôt un peu
plus petite, que ma salle à manger américaine. Je suis retournée au grenier où
j’avais entendu de jeunes sionistes et Léo Baeck, et je me suis dit que c’était
sans doute pour Rosh Hashanah, puisqu’il avait parlé de la création du
monde. Puis j’ai rôdé dans des rues où des enfants jouaient, je voyais parmi
eux mes fantômes, aux contours nets et précis, mais transparents, comme sont et
doivent être les esprits, alors que les enfants vivants étaient concrets, bruyants
et solides. Je suis partie rassurée. Theresienstadt n’était pas devenue un
musée. C’était une petite ville, où vivaient des gens. Après la triste ville de
garnison de Ferdinand von Saar dans les années 1840, et mon camp de transit des
années 1940, on a pu se réhabituer à y vivre.
AUSCHWITZ-BIRKENAU
I
Si seulement la guerre pouvait finir à temps. De toute la
période hitlérienne, je n’ai jamais entendu un seul Juif exprimer la pensée que
l’Allemagne pût l’emporter. C’était une possibilité qui revenait à une
impossibilité, une phrase tabou, une pensée qu’on ne menait jamais à son terme.
L’espoir était un devoir.
Ce mot reviendra souvent dans les pages suivantes. En hébreu
espoir se dit hatikvah*. C’est aussi le titre d’une chanson. Il paraît
que ceux qu’on emmenait dans les chambres à gaz la chantaient parfois dans les
camions, c’était alors l’hymne sioniste, c’est aujourd’hui l’hymne d’Israël. On
dit certes que l’espoir fait vivre. Mais en réalité
Weitere Kostenlose Bücher