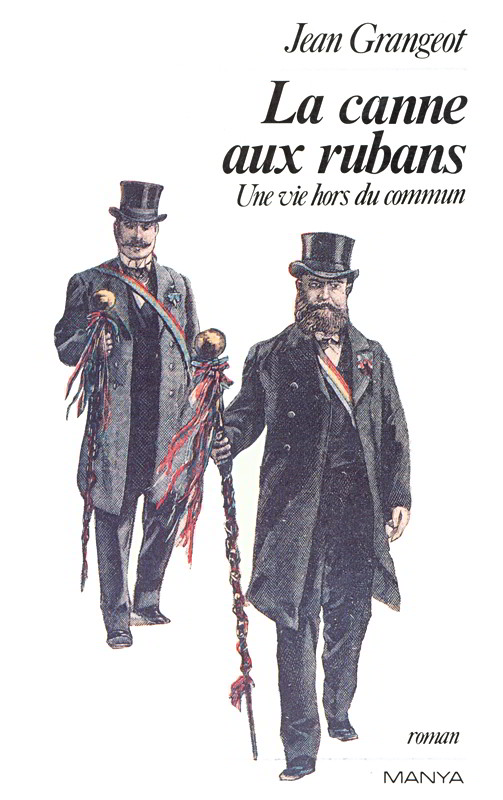![La canne aux rubans]()
La canne aux rubans
m’envoyer des
charpentiers, si possible aptes à travailler le fer.
Deux jours après, la réponse me parvient : « Cinquante-deux
coteries arriveront à Bilbao sous deux jours – stop – les attendre en
gare. »
Durant ces quatre longs jours, je fais un inventaire ;
je constate ainsi que des vols nombreux ont été perpétrés. J’envoie un rapport
à mon singe, lui expliquant que la situation ne tardera pas à être rétablie.
J’ajoute qu’il veuille bien me faire parvenir de nouvelles pièces
indispensables. J’en profite pour le rassurer en lui confirmant que les délais
seront respectés. J’emménage définitivement dans l’hôtel situé en face du
chantier. Ma fenêtre donne directement sur les entrepôts que je peux surveiller
la nuit. La petite soubrette de l’étage me rejoint souvent après son travail.
Angelina, fille nerveuse et gourmande, a l’avantage de voir la nuit, un peu
comme les chats. Entre deux abandons nous nous relayons gentiment pour
surveiller. Je constate vite qu’on ne peut rester éveillé la nuit et travailler
dans la journée. Enfin, Charles Bontemps et moi allons à la gare accueillir les
compagnons arrivant sourire aux lèvres en chantant. J’en reconnais beaucoup,
d’autres se rappellent à moi. À tour de rôle, deux par deux, des volontaires
dormiront dans les entrepôts. Je pourrai prendre enfin un peu de repos et de
vrai plaisir avec Angelina. Je redresse la situation, reçois la commande
d’Eiffel ordonnée par Arnodin.
Un jour Piso me confie : « Vous avez réalisé ce
que votre prédécesseur aurait dû immédiatement entreprendre, mais il ne
possédait pas votre fermeté. » Ces paroles encourageantes me touchent.
D’une part, le manque de recul rend les travaux difficiles sur le
terrain ; d’autre part, les estivants commencent à envahir la plage et les
badauds affluent. Des ouvriers espagnols réapparaissent afin de se faire
embaucher. Quelques ouvriers français baragouinent l’espagnol, mais ignorent
l’occitan. Piso et Bontemps perdent leurs précieuses minutes en servant
d’interprètes.
À l’occasion d’une visite au chantier, monsieur Arnodin me
présente Alberto de Palacio. Ils me complimentent d’avoir repris l’affaire en
main. Dans quatre mois, le pont transbordeur fonctionnera. Nos conversations
techniques s’expriment dans un climat détendu. Le dimanche, Palacio nous
entraîne à la corrida ; y assistant pour la première fois, j’appréhende un
peu ma réaction. L’ambiance populaire constitue à elle seule un spectacle.
J’aperçois de ma place les personnalités de la ville dans la tribune d’honneur.
Les hommes fument le cigare et tentent de présenter un comportement dédaigneux
différent des spectateurs assis sur les gradins. Les femmes, vêtues de toilettes
en soie de couleurs vives recouvertes de dentelles, une grosse fleur rouge dans
leurs cheveux noirs, agitent des éventails derrière lesquels elles se cachent.
La foule, elle, participe totalement à la corrida. Les cris, semblables aux
vagues d’une mer déchaînée, reflètent tous les gestes du toréador qui se joue
de la fougue du « toro bravo ». Des milliers de chemises blanches
battent la mesure en un ballet dont le toréador serait le maître. Palacio dans
un très bon français m’explique quelques figures de ce jeu tragique et me
désigne le nom des différents participants, que je ne retiens pas. Je tente de
saisir le rituel car rien ne me paraît improvisé, en dehors des surprises
qu’offrent les humeurs de la bête. Je ne peux m’empêcher de penser aux bovins de
nos campagnes françaises que les gamins tentent d’agacer, mais qui préfèrent la
fuite paresseuse au combat. Après des jeux de jambes élégants, des gestes
précis provoquant toujours une fatigue et une perte de sang chez l’animal,
celui-ci vit ses dernières minutes. Le public hurle sa joie lors de la mise à
mort. J’avoue, pour ma part, éprouver un certain dégoût mêlé d’un sentiment
d’injustice. On sent que les dés sont pipés. Je reconnais dans ce spectacle la
beauté des gestes et des habits des tragédiens. Arnodin est ravi, Palacio
jubile, le public a joui, le taureau a tout donné. Des chevaux, attelés au
corps de la bête, la traînent dans les coulisses. Tard le soir nous nous
régalons dans une cerveceria, ou brasserie, d’anguilles à la bilbaina absolument
délicieuses. Je goûte ensuite à un fromage nommé Rocal de Navarre, fort et
Weitere Kostenlose Bücher