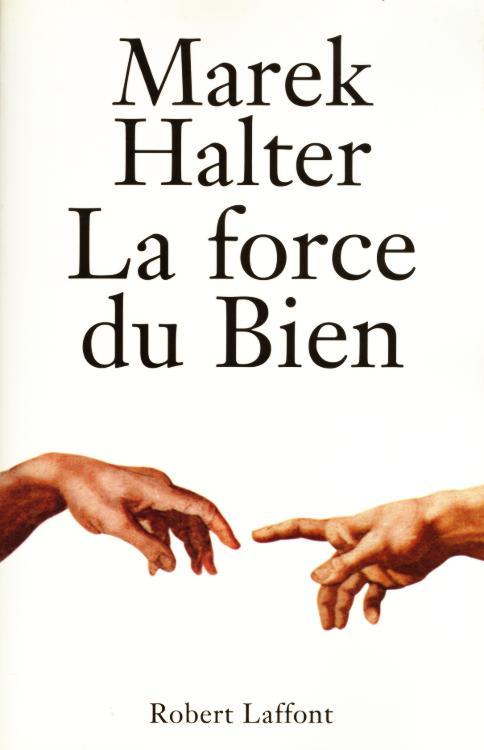![La force du bien]()
La force du bien
Lucienne Guyollot tenait un café-restaurant où venaient beaucoup d’Allemands. Un jour l’un d’eux, un officier, est allé à l’étage, et il est entré dans ma chambre. Il y a vu, sur la cheminée, une photo de mes parents. Il est redescendu au restaurant : “ Cette photo, ce sont les parents des enfants : des Juifs, a-t-il dit à Lucienne Guyollot. Pourquoi faites-vous ça ? ” Ma tante a essayé (ma tante, c’est ainsi que ma soeur et moi appelons Mme Guyollot) de bredouiller des explications sans se trahir. Alors l’officier allemand s’est contenté de lui répondre : “ C’est humain, c’est humain… ” Il n’a jamais dénoncé ma tante. Vous voyez : il y a eu une espèce de chaîne de solidarité, y compris avec des maillons imprévus, comme la discrétion, la compréhension de cet Allemand. »
Que se serait-il passé, nous sommes-nous demandé avec Paul Ricoeur, si cet officier allemand avait trouvé, chez Lucienne Guyollot, non pas la photo d’un couple juif dont elle cachait les enfants, mais un revolver utilisé par la Résistance ? Il aurait pu dégainer son propre revolver pour abattre Lucienne Guyollot, et d’autres villageois avec elle. Car il aurait retrouvé alors un langage qu’il connaissait bien : celui de la violence. En face de sa propre et injuste violence, il aurait rencontré, avec ce revolver supposé, la violence au service de la justice : juste violence, certes, mais violence tout de même. Par réflexe, par habitude, il lui aurait opposé la sienne.
Mais ici, confronté à un langage dont il ne maîtrisait pas les règles – un langage qui s’adressait à cette part de son être engloutie sous une épaisse couche d’idéologie, d’éducation et de pulsions naturelles du Mal –, il a été déstabilisé. Et sous son uniforme nazi, dans le coeur de l’homme qu’il était, s’est réveillée pour un instant cette étincelle d’humanité, cette flammèche de l’immémoriale connaissance du Bien que, depuis le début de mon aventure, j’espère débusquer.
Cet officier allemand n’a pas déjeuné ce jour-là, ni les jours suivants, dans l’auberge de Lucienne Guyollot. Il n’y est jamais revenu. Comme s’il avait craint d’être malgré tout tenté de retomber dans le Mal, et d’accomplir son « devoir » de nazi.
Pierre Saragoussi poursuit :
« Ces deux femmes, Élise Caron et Lucienne Guyollot en particulier, ont fait des gestes… de très beaux gestes en vérité, et j’ai toujours conservé une grande admiration à leur égard. Parce que en fait, dans ces cas-là, vous savez, on se pose la question : “ Et toi, qu’aurais-tu fait ? ” C’est vrai : en fait, on n’est jamais sûr, soi-même, de pouvoir accomplir des actes aussi forts, de pouvoir, en ces périodes terribles, risquer sa vie pour les autres, comme elles l’ont fait. »
Pierre Saragoussi pleure presque, une photo de ses parents à la main.
« Il y a quelque chose dont j’ai pris conscience ces temps-ci, ajoute-t-il. Lorsque ma soeur et moi montions dans le train pour l’Yonne, pour Appoigny, vers le sud, vers la vie, au même moment mes parents étaient embarqués dans un convoi qui allait, lui, en sens inverse : vers la mort… »
Pierre Saragoussi se tait.
Un peu plus tard, il répond de nouveau à mes questions :
« Avez-vous retrouvé, depuis, ce policier qui vous a sauvé la vie en vous confiant à Mme Caron après avoir falsifié les papiers de vos parents pour les déclarer “ sans enfants ” ?
— Je ne suis retourné à Paris qu’en 1960. Non, hélas, je ne l’ai jamais retrouvé…
— Quels sont aujourd’hui vos rapports avec Lucienne Guyollot ?
— Vous savez, à Appoigny, Lucienne est devenue notre mère, même si nous l’appelions notre tante… Elle est encore en vie, quoique très âgée. Ma soeur et moi l’avons installée à Nice, où nous allons la voir souvent.
— Pierre, vous avez mentionné le rôle de la police française dans les rafles successives contre les Juifs. Vos parents ont été victimes de ces rafles, et vous-même, grâce à un policier parisien, avez été sauvé. Pensez-vous qu’il y ait eu beaucoup de policiers comme celui-là ? Beaucoup de policiers capables de prendre des risques pour soustraire deux enfants juifs à la mort ?
— En fait, je trouve ça admirable parce que exemplaire. Très souvent, trop souvent, on pense qu’on ne peut rien faire, que l’on appartient à un corps
Weitere Kostenlose Bücher