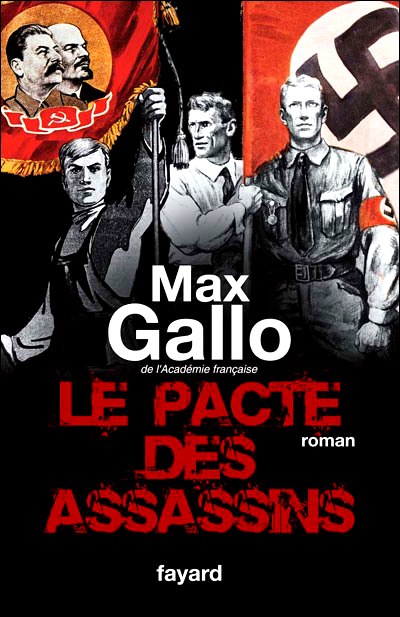![Le Pacte des assassins]()
Le Pacte des assassins
ses poings contre
ses paupières, il les enfonce jusqu’à ce que la douleur soit trop forte, qu’il
ait l’impression qu’il va faire éclater ses yeux.
Il pose son front sur ses paumes, reste longtemps
ainsi. Il ne voudrait parler que de l’enfance de son fils, raconter comme ils
se rendaient ensemble aux manifestations, comme il soulevait Henri, le prenant
sous les aisselles, afin qu’il pût voir la tribune et cette foule qui vibrait
et ondulait comme l’océan.
C’est en 1930, en
1934.
Henri, en février de cette année-là, a
quatorze ans et il s’est mêlé aux cortèges. Il a été emporté par les émeutes, piétiné
par les charges de police.
François Ripert a alors commencé à avoir peur.
Il a demandé à Isabelle de prendre soin de son frère, de le raisonner : lui,
n’avait plus le temps, les responsabilités s’accumulaient, les audiences au
cours desquelles il défendait les manifestants se multipliaient.
Chaque fois qu’il le pouvait, il s’efforçait
de dialoguer avec Henri, mais son fils l’interrompait avec un sourire :
« Nous sommes d’accord sur tout, papa. »
Il arrivait souvent
à François Ripert de penser que son fils était comme la réalisation d’un rêve
secret qu’il avait toujours porté.
L’adolescent était beau : cheveux bouclés
sur un front vaste, regard joyeux, traits réguliers. Le visage de sa mère, morte
alors qu’il avait trois ans.
Chacun des gestes de Henri, chacune de ses
phrases révélaient la vivacité, la générosité, l’intelligence. Premier prix au
concours général de philosophie, licence, diplôme sur « la religion chez
Marx », mention très bien. Et comme si Henri avait le don de vivre
plusieurs vies, il donnait des cours de marxisme à l’Université Nouvelle créée
pour le peuple en 1936, il distribuait des tracts, vendait L’Humanité , faisait
le coup de poing contre les Jeunesses patriotes, rue Soufflot, devant la
faculté de droit.
Il rentrait au milieu de la nuit et écrivait.
Mais, parfois, ce
rêve qui comblait François Ripert de fierté et de joie devenait tout à coup
cauchemar.
François Ripert s’affolait.
Trop parfait, ce fils, trop exposé, trop
généreux.
Henri avait voulu s’engager à seize ans dans
les Brigades internationales afin de combattre le fascisme les armes à la main.
Trop jeune pour l’Espagne.
Mais François Ripert savait qu’il ne pourrait
plus le retenir, que Henri lui avait échappé. Et l’inquiétude, l’effroi le
paralysaient.
Il s’accusait de n’avoir pas mis en garde son
fils contre les dangers. Il l’eût voulu prudent, il l’aurait même, en ces
instants-là, souhaité indifférent à la politique, à la philosophie, insensible
aux injustices.
Il lui semblait avoir déposé son fils sur l’autel
du sacrifice. Il craignait qu’« ON » ne retînt pas la main tenant le
coutelas. Car « ON » n’était pas le dieu compréhensif, compassionnel,
mais l’Histoire impitoyable qui frappait sans se soucier de la peine des hommes.
De ce qu’était ce fils, pour François Ripert.
Quand la guerre vint, l’angoisse se fit si
forte que le seul moyen que François Ripert eût de la contenir fut de s’enfoncer
dans l’action, de prendre des risques, d’accepter toutes les tâches, comme s’il
avait pu ainsi attirer sur lui le malheur, et de cette manière en protéger son
fils.
C’est François
Ripert lui-même qui, dans ses « aveux », analyse avec lucidité son
comportement, ses relations avec son fils :
« À compter du
mois de mai 1940, je n’ai plus qu’entrevu Henri, écrit-il.
Nous nous embrassions longuement, agrippés l’un
à l’autre, nos doigts se crispant sur nos épaules.
Nous ne parlions pas.
C’est par Isabelle que j’ai appris que Henri
préparait l’agrégation de philosophie, mais elle ne savait rien d’autre de sa
vie. Et moi, quand je le voyais, l’espace de quelques minutes, je n’osais l’interroger.
Nous appliquions l’un et l’autre la règle du “cloisonnement”.
Comment d’ailleurs aurai-je pu lui avouer que j’avais préparé avec Alfred
Berger une rencontre entre une délégation communiste et les autorités
allemandes d’occupation ?
« Je n’avais eu
nul besoin des confidences de Henri pour savoir que mon fils n’avait qu’une
seule obsession : combattre les nazis, les chasser hors de France, qu’il
avait toujours en tête le mot d’ordre tant de fois répété : “Le fascisme
ne passera
Weitere Kostenlose Bücher