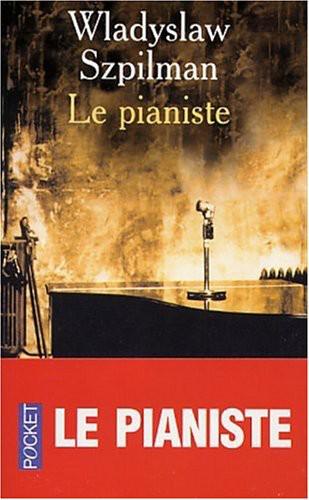![Le pianiste]()
Le pianiste
survécu à cette épreuve si je n’étais
pas parvenu à convaincre notre chef de groupe de demander mon transfert au
chantier de rénovation du petit palais des allées Ujazdowskie destiné au
commandement SS. Là-bas, les conditions de travail étaient moins pénibles, notamment
parce que nous étions au coude à coude avec des maçons allemands et des
artisans qualifiés polonais, certains en régime de travail forcé comme nous
mais d’autres employés sous contrat. Du coup, notre statut de forçats juifs
était moins immédiatement reconnaissable au milieu d’eux, ce qui nous
permettait de nous relayer pour marquer des pauses sans nous exposer à des
punitions. De plus, les Polonais faisaient cause commune avec nous contre les
contremaîtres allemands et nous aidaient dans les tâches les plus difficiles. Il
y avait encore un autre point positif : Blum, l’architecte responsable du
projet, était lui-même juif et avait une équipe d’ingénieurs également juifs
autour de lui, tous de remarquables professionnels. Officiellement, les
Allemands ne reconnaissaient pas cet état de fait, la direction des travaux
revenant pour la forme au maître artisan Schultke, un individu absolument
sadique qui avait le droit de frapper les ingénieurs de la « race
inférieure » et ne s’en privait pas. Mais comme le savoir-faire de ces
hommes de l’art était indispensable à la réalisation du chantier ils étaient
relativement bien traités. À part les coups distribués par le sinistre Schultke,
évidemment, mais dans le climat de l’époque c’était presque négligeable…
Je servais de manœuvre à un maçon polonais du nom de
Bartczak. C’était quelqu’un de très correct, fondamentalement, même si des
frictions inévitables survenaient entre nous quand les Allemands décidaient de
nous surveiller de plus près et que nous devions accélérer la cadence. Malgré
toute ma bonne volonté, il m’arrivait alors de renverser l’échelle, de faire
tomber de l’échafaudage un seau de chaux ou quelques briques. Alors Bartczak
était lui aussi réprimandé et il bouillait de colère contre moi. Le rouge au
front, marmonnant dans sa barbe, il attendait que les gardes se soient éloignés
pour repousser sa casquette en arrière, se camper les poings sur les hanches
devant moi et railler ma maladresse par une invariable tirade : « Comment
ça, Szpilman ? Je croyais que tu jouais du piano à la radio, avant ? Un
musicien comme toi… Et tu ne peux même pas tenir une pelle ou enlever un peu de
chaux d’une planche ! Ah ! ils devaient tous s’endormir, quand tu te
mettais devant le clavier ! » Puis, sans me quitter de ses yeux
sceptiques, il haussait les épaules et concluait son attaque en hurlant de tous
ses poumons : « Abruti ! »
Mais si d’aventure je me laissais aller dans de sombres
rêveries jusqu’à en oublier mon travail, et même là où je me trouvais, il s’arrangeait
toujours pour me secouer avant qu’un contremaître allemand ne me découvre dans
cet état. « Mortier ! », criait-il alors à tue-tête, et j’attrapais
le premier seau à portée de main, ou la truelle, en prenant un air très affairé.
La perspective de l’hiver, désormais imminent, était au
centre de mes idées noires. Je n’avais pas de vêtements chauds, et encore moins
de gants. Ayant toujours été plutôt frileux, j’imaginais déjà mes mains geler
sur le chantier, ce qui ruinerait à jamais toute éventualité de reprendre ma
carrière de pianiste au cas où j’échapperais à la mort. Alors je regardais avec
une anxiété grandissante les feuilles virer de couleur sur les arbres de l’avenue
tandis que la bise se faisait chaque jour plus glaciale.
À ce stade, les numéros qui nous avaient assuré un sursis
provisoire avaient pris valeur de statut permanent. Au même moment, j’ai été
affecté à un nouveau logement, rue Kurza, toujours dans le ghetto. Nous avons
également changé de lieu de travail car la réfection du palais des allées
Ujazdowskie s’achevait et ne nécessitait plus autant d’ouvriers. Certains d’entre
nous ont été transférés au 8 de la rue Narbutt, en quartier « aryen »,
afin de préparer des appartements pour plusieurs officiers SS.
Le froid était de plus en plus vif. Au travail, il m’arrivait
toujours plus souvent de sentir mes doigts s’engourdir jusqu’à en devenir
inertes. Je ne sais pas ce que je serais devenu si le hasard n’était
Weitere Kostenlose Bücher