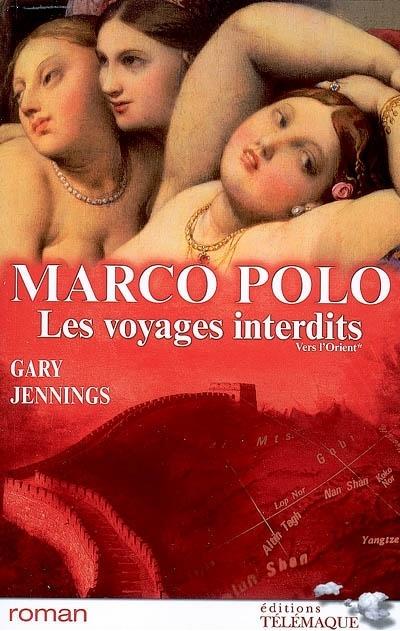![Les voyages interdits]()
Les voyages interdits
qu’on y servait avaient au moins l’avantage d’offrir une
certaine variété. Plus loin vers l’est, les caravansérails ne furent bientôt
plus régis que par des Arabes qui signalaient leur auberge du panneau :
« Ici, l’on pratique la vraie et la pure religion. » Si la propreté
et la tenue y étaient meilleures, les plats proposés étaient quant à eux d’une
désespérante monotonie : du mouton, du riz, un pain ayant à peu près la
taille, la forme, la texture et le goût d’un siège de chaise en osier, le tout
arrosé de sharbats fadasses, tièdes et outrageusement coupés d’eau.
À quelques jours de Suvediye, nous atteignîmes au bord
du fleuve la ville d’Antakya. Lorsque vous voyagez ainsi par voie terrestre,
toute agglomération pointant sur l’horizon est regardée avec bienveillance. De
loin, on a tendance à la considérer comme belle. Hélas, cette impression
trompeuse s’estompe à mesure que l’on s’en approche.
Antakya n’était en réalité, comme toutes les autres
villes de cette région, qu’un affreux ramassis de taudis aussi sales
qu’ennuyeux, infesté de son essaim de mendiants. Mais elle avait au moins le
titre de gloire d’avoir donné son nom à la terre d’Antioche qui l’entoure,
telle qu’elle est nommée dans la Bible. Plus tard, lorsqu’elle fit partie de
l’empire d’Alexandre, cette terre fut appelée Syrie. Au moment où nous la
traversâmes, elle ne formait plus qu’une annexe du royaume de Jérusalem, tout
au moins de ce qu’il en restait, puisqu’elle est retombée depuis sous la férule
de ces Sarrasins que sont les Mamelouks. Je fis néanmoins mon possible pour
envisager cette ville et la région qui l’environnait avec l’œil d’Alexandre,
tout gonflé de fierté que j’étais de fouler à mon tour les terres qu’avait
arpentées, naguère, le glorieux conquérant.
Là, à Antakya, la rivière Oronte s’oriente vers le
sud. Aussi quittâmes-nous son tracé pour continuer à l’est en direction d’une
autre cité qui, pour être plus vaste, n’en était pas moins désolée : celle
de Haleb, ou Alep, comme l’orthographient les Occidentaux. Nous y passâmes la nuit
dans un caravansérail où le tenancier nous conseilla d’échanger nos vêtements
vénitiens contre le costume léger des Arabes bien mieux adapté aux conditions
de notre voyage. En quittant Alep, nous arborions désormais la parfaite
panoplie du caravanier levantin, du keffieh ceignant la tête aux amples
draperies couvrant les jambes. Il faut reconnaître que ce vêtement est
incomparablement plus pratique pour voyager à cheval que la tunique et les
chausses vénitiennes, plus moulantes. Et, au moins de loin, nous ressemblions
vraiment à trois de ces nomades arabes qui s’appellent eux-mêmes les arpenteurs
du vide, ou bedawin.
La plupart des caravansérails de la région étant tenus
par des Arabes, j’assimilai bien sûr un grand nombre de mots de leur langue.
Mais ces commerçants pratiquaient aussi le langage universel de l’Asie, le
farsi, et nous nous rapprochions chaque jour de la Perse dont c’est l’idiome
originel. Aussi, dans le but de m’initier plus rapidement à cette langue, mon
père et mon oncle s’efforcèrent dès lors de communiquer dans ce qu’ils
connaissaient de farsi, au lieu de notre dialecte vénitien ou du sabir
français. Et pour le coup, j’appris. Je trouvai même le farsi beaucoup moins
compliqué que bien des langues auxquelles j’ai dû me confronter par la suite.
Il faut croire en outre que les jeunes gens ont plus de facilité dans
l’acquisition que leurs aînés, car je ne fus pas long à maîtriser le farsi bien
mieux que mon oncle et mon père n’avaient réussi à le faire.
Un peu à l’est d’Alep, nous atteignîmes le fleuve
suivant, le Furat, plus connu sous le nom d’Euphrate, que la Genèse mentionne
comme l’un des quatre cours d’eau arrosant le jardin d’Eden. Loin de moi l’idée
de vouloir contredire la Bible, mais sur toute la longueur de ce fleuve je ne
vis pas grand-chose qui puisse mériter le nom de jardin. À l’endroit où nous le
rejoignîmes pour en suivre le cours en direction du sud-est, ses eaux,
contrairement à celles de l’Oronte, ne coulaient pas dans une vallée riante.
Elles se contentaient d’errer de façon vagabonde au milieu d’une contrée sans
relief, une immense prairie herbeuse qui servait de pâture aux troupeaux de
chèvres et de moutons. Si l’élevage
Weitere Kostenlose Bücher