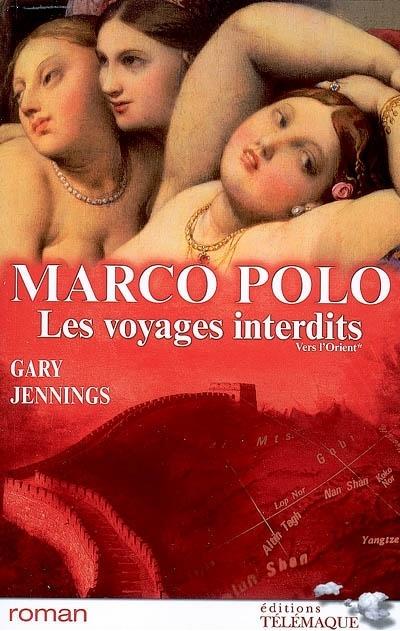![Les voyages interdits]()
Les voyages interdits
ne fus guère impressionné par Acre (Akko, comme l’appelaient ses habitants). La ville, aussi sale que le port,
n’offrait à voir que de sordides bâtiments, et ses avenues les plus larges
étaient plus étroites que les plus modestes venelles de Venise. Les rares zones
un tant soit peu ouvertes empestaient l’urine, et les parties closes des murs
étaient plus méphitiques encore, car ce n’étaient qu’égouts à ciel ouvert dans
lesquels des chiens décharnés disputaient les débris à des rats monstrueux qui
sortaient même en plein jour.
Plus encore que l’odeur de Saint-Jean d’Acre, c’est
son bruit qui vous accablait. Dans toutes les ruelles assez larges pour y
étaler une carpette, une multitude de vendeurs, accroupis épaule contre épaule
derrière leurs petits tas de marchandises de pacotille (foulards et rubans,
oranges racornies, figues blettes, coquillages de pèlerin, feuilles de
palmiers), hurlaient à pleins poumons afin d’être entendus de plus loin que les
autres. Mendiants, culs-de-jatte, aveugles ou lépreux geignaient, larmoyaient
et tentaient de vous agripper au passage. Des ânes, des chevaux et des chameaux [17] au pelage
miteux (les premiers que j’eusse jamais vus) nous bousculaient en chemin,
avançant d’un pas traînant parmi les ordures dans les rues étroites. Tous
avaient l’air épuisé et misérable sous le poids de leurs lourds fardeaux, mais
ils n’avaient d’autre choix que de se soumettre aux coups de bâton et aux
imprécations que leur vociféraient leurs maîtres. Des groupes d’hommes de
toutes nations, qui se tenaient debout, conversaient à tue-tête. Je suppose que
la majeure partie de leurs propos concernait des sujets aussi ordinaires que le
commerce, la guerre ou le temps, mais leurs échanges étaient si bruyants qu’on
aurait juré qu’ils étaient en train de se quereller rageusement.
Dès que nous pûmes emprunter une rue assez large pour
cheminer côte à côte, j’entrepris mon père au sujet d’une question qui me
tourmentait :
— Tu as bien dit que tu emportais des
marchandises à échanger au cours de ce voyage, n’est-ce pas ? Pourtant, je
n’ai rien vu charger de tel dans l’Anafesto, à Venise, et je ne vois
toujours rien de cette nature à l’heure actuelle. Est-il resté un chargement
dans le bateau que je n’aurais point vu ?
Il secoua négativement la tête.
— Prendre le risque de convoyer jusqu’ici de
telles denrées n’eût fait qu’éveiller la convoitise d’innombrables bandits et
voleurs.
Il souleva alors un petit paquet qu’il portait
lui-même, ayant refusé de le confier à aucun des porteurs.
— Au lieu de cela, nous transportons quelque
chose de léger et de fort discret, mais dont la valeur marchande est énorme.
— Du safran ! m’exclamai-je.
— Tout juste. Un peu sous forme de brique
pressée, un peu en poudre, tel que récolté. Et quelques semences du crocus qui
le produit.
Je partis d’un éclat de rire.
— Tu ne vas tout de même pas t’arrêter pour en
planter et attendre qu’un an s’écoule avant la récolte !
— Qui sait, si les circonstances
l’exigeaient ? Il faut parer toute éventualité, mon garçon. Aide-toi, et
le Ciel t’aidera. Nous ne serions pas les premiers voyageurs à pratiquer la
marche des trois haricots.
— Pardon ?
Mon oncle vint éclaircir ma lanterne.
— Le célèbre et redouté Gengis khan, le
grand-père de notre Kubilaï, conquit une bonne partie du monde en marchant de
cette façon lente. Ses armées et leurs familles eurent à traverser la
quasi-totalité de l’immense Asie, et ils étaient bien trop nombreux pour se
nourrir de pillages et de rapines. Non, pour subsister, ils avaient tout
simplement emporté avec eux des graines afin de les semer et des animaux
susceptibles d’être élevés. Dès qu’ils avaient épuisé les vivres dont ils
disposaient et progressé plus loin que ne pouvaient les rejoindre leurs convois
de ravitaillement, ils cessaient leur avancée et s’établissaient sur place. Ils
plantaient leurs grains et leurs haricots, prenaient soin d’élever leurs
chevaux et leur bétail, et attendaient de pouvoir en récolter le produit. Dès
qu’ils avaient réussi à se ravitailler et à se constituer des réserves
suffisantes, ils repartaient vers leur prochain objectif.
— J’ai ouï dire que, parfois, ils choisissaient
un de leurs hommes sur dix et le mangeaient.
— Fadaises ! tonna mon oncle.
Weitere Kostenlose Bücher