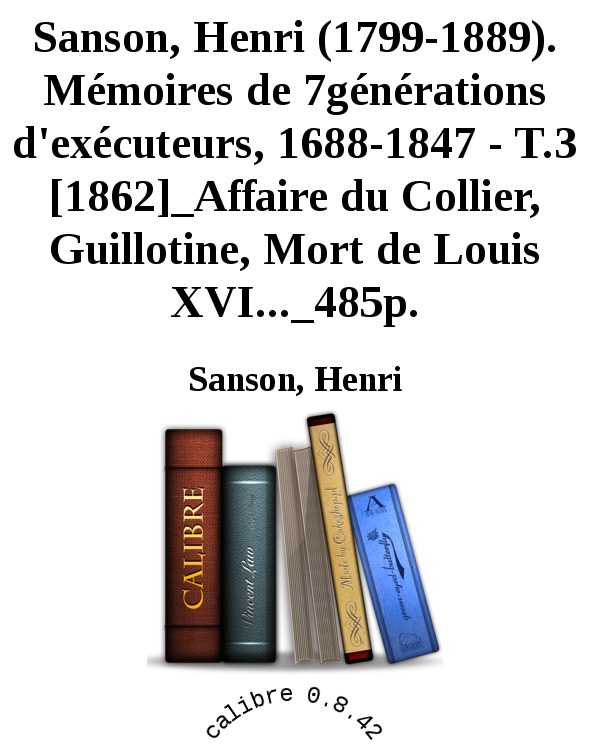![Mémoires de 7 générations d'exécuteurs]()
Mémoires de 7 générations d'exécuteurs
nombreux co-héritiers, fut forcé de vendre l’hôtel du faubourg Poissonnière pour faciliter le partage de la succession. J’ai raconté par anticipation, dans le second volume, comment deux spéculateurs sur les terrains, nommés Papillon et Riboutté, firent l’acquisition de cet immeuble et de ses dépendances, y construisirent deux rues qui portent encore leur nom, et firent sans doute une excellente opération, bien que mon grand-père et ses co-héritiers eussent aussi réalisé un bénéfice considérable par suite de l’augmentation de la valeur des terrains depuis l’époque où Charles Sanson II avait acheté cette propriété.
Cependant, mon grand-père ne voulut pas s’éloigner beaucoup de ce quartier où ses ancêtres étaient parvenus, par une vie méritante et exemplaire, à entourer leur nom de quelque considération, et à se faire pardonner des fonctions chargées de la réprobation publique. C’est donc à peu de distance de la demeure qu’il quittait qu’il en choisit une nouvelle. Une maison, que sans de grands et coûteux aménagements il pouvait approprier à ses besoins, se trouvait en vente rue Neuve-Saint-Jean (aujourd’hui rue du Çhâteau-d’Eau), n°16 ; il l’acheta, et vint s’y établir avec sa famille.
Cette maison, sans être aussi vaste que celle du faubourg Poissonnière, n’était pas moins confortable. Elle offrait surtout cet avantage, que les appartements dans lesquels mon grand-père recevait le public étaient complètement séparés de l’habitation de famille. On entrait d’abord, dans une grande cour carrée longue, à l’exception d’un des angles, légèrement écorné, et où se trouvait placée la grille qui donnait accès dans la maison. Les bâtiments étaient à droite ; ils comprenaient : au rez-de-chaussée, pour l’habitation, un vestibule, une vaste salle à manger et une cuisine ; pour mon grand-père, une antichambre et un cabinet de réception, une belle pharmacie et un laboratoire ; aux étages supérieurs, les chambres à coucher. D’autres bâtiments ; se prolongeant au delà de la cour, sur une seule ligne qui continuait celle du mur d’enceinte, formaient une succession de servitudes, telles que remise, écurie, bûcher, buanderie, etc. Le long de ces derniers bâtiments était un parterre, et enfin à l’extrémité, sur toute la largeur de la propriété, un jardin potager. Bon sang ne peut mentir ; ma grand’mère n’avait pu oublier entièrement les occupations de sa jeunesse, et c’était pour elle une douce distraction que de diriger et de surveiller la culture de ce parterre et de ce potager, qui réalisaient à eux deux le fameux : miscuit utile dulci.
Ce n’était plus le quasi-parc du faubourg Poissonnière ; mais enfin ce n’en était pas moins quelque chose d’agréable, et tout ce qu’on avait pu tirer de la superficie du terrain, tout ce que Charles-Henry Sanson, du reste, pouvait ambitionner dans une situation de fortune bien inférieure à celle de son père et de son aïeul.
De 1778 à 1789, la vie s’écoula calme, austère, patriarcale dans cette maison, que ne franchissaient pas les bruits du dehors. Tout le monde y subissait l’ascendant des vertus et de la bonté de Marie-Anne Jugier. Jamais il n’y était fait la moindre allusion aux sanglantes occupations qui venaient trop souvent interrompre, pour les hommes, la paix de cette existence. Si parfois il arrivait à un des aides qui s’asseyaient à la table des maîtres de laisser échapper une parole imprudente se rattachant à quelque chose du métier, un sévère regard de mon grand-père réprimait cet oubli, et la conversation reprenait aussitôt son cours en se portant sur d’autres sujets.
Les heures des repas étaient les mêmes que du temps de Jean-Baptiste Sanson ; mais ma grand’mère réunissait en outre, deux fois par, jour, toute la maison pour les prières du matin et pour celles du soir. Mon grand-père ne manquait aucune de ces pieuses réunions, et y assistait dans l’attitude du plus profond recueillement. Marie-Anne Jugier, agenouillée dans la salle à manger sur un prie-dieu au-dessus duquel était appendu un grand christ d’ivoire, récitait à haute voix les prières, et l’assistance lui faisait écho pour les paroles qui doivent être dites en commun. Je puis d’autant mieux parler de ce touchant usage, qu’il s’est toujours conservé dans ma famille, et que, ayant déjà atteint l’âge
Weitere Kostenlose Bücher