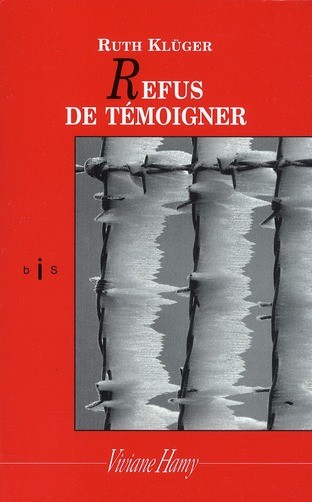![Refus de témoigner]()
Refus de témoigner
Ainsi les uns sont-ils sous l’emprise
d’une sorte d’épouvante qui fait que tous les camps se fondent dans une brume d’horreur,
où on ne saurait distinguer les détails, par conséquent à quoi bon essayer ?
Ils ne veulent pas entendre qu’en dernier ressort j’ai trouvé à Theresienstadt
un milieu plus favorable pour un enfant que celui de la Vienne des derniers
temps ; ils ne veulent pas l’entendre parce que cela bousculerait les
délimitations claires de leur pensée. Et d’autres, comme cette Gisela, font l’inverse,
ils refusent de se lever du canapé confortable de leur vie quotidienne pour
regarder par la fenêtre. Sans se soucier des informations, autrement dit des
incitations, ou des idées venues de l’extérieur, des difficultés causées par la
réflexion, ils tirent leurs conclusions, sans mesurer toute la charge
inconsciente dont sont entachées leurs comparaisons. L’air de supériorité de
Gisela était d’une agressivité inouïe. Elle m’en voulait certainement, entre
autres, de ne pas porter de manches longues quand il fait chaud ou de ne pas
chercher à cacher de quelque autre façon, par exemple avec un bracelet, le
numéro d’Auschwitz tatoué sur mon bras. Theresienstadt était bien « un
ghetto pour les vieux et les vétérans Juifs ». Cette interlocutrice, tout
à fait représentative de la moyenne, conclurait triomphalement mon récit sur
Theresienstadt en disant : « Vous voyez bien ! On était même
mieux que dans la belle ville de Vienne, dans ce ghetto ! »
Aujourd’hui Theresienstadt m’apparaît comme une chaîne de
souvenirs sur des personnes que j’ai perdues : autant de fils interrompus,
qui n’ont pas été filés plus loin. Theresienstadt, c’était la faim et la
maladie. Le ghetto, avec son quadrillage militaire de rues et de places, était
extrêmement pollué, il était limité par un mur de fortifications que je n’avais
pas le droit de franchir, et surpeuplé à tel point qu’il était presque
impossible de trouver un coin où parler avec quelqu’un, de telle sorte qu’on
éprouvait comme un sentiment de triomphe lorsque malgré tout, en se donnant un
peu de mal, on arrivait quand même à trouver une petite place. Au-delà d’un kilomètre
carré, on n’avait aucune liberté de mouvement, et à l’intérieur de l’enceinte
on était livré corps et âme à une volonté anonyme qui pouvait à tout instant
vous envoyer dans un camp de l’horreur dont on se faisait une confuse idée. Car
Theresienstadt, c’étaient ces convois vers l’est intervenant par intervalles, de
façon imprévisible, comme des catastrophes naturelles. Tel était le cadre dans
lequel nous devions penser notre existence, ces allées et venues de personnes
qui n’avaient pas la libre disposition d’elles-mêmes, qui ne pouvaient exercer
aucune influence sur ce qu’on ferait d’elles, ni ne savaient de quelle façon on
le ferait, et qui ne savaient même pas quand et si on ferait encore quelque
chose d’elles. Elles savaient uniquement que l’intention était hostile.
Lorsque nous arrivâmes et que nous vîmes les conditions de
logement, une petite pièce que partageaient plusieurs personnes, et une plus
grande pièce que partageaient un grand nombre d’autres, un jeune homme de l’administration
juive du camp proposa à ma mère de me loger au foyer des enfants. Elle pourrait
aller me voir aussi souvent qu’elle le voudrait, moi aussi, et je serais quand
même avec d’autres enfants, ce qui vaudrait mieux que d’habiter ailleurs avec
des personnes âgées.
Des deux côtés de l’église fermée de la petite ville, il y
avait deux imposantes casernes d’officiers, L 410 et L 414. L’administration
juive du camp avait logé dans l’une des enfants qui parlaient tchèque, dans l’autre
ceux qui parlaient allemand. Je fus intégrée au L 414, dans le groupe de filles
les plus jeunes, ou celui qui venait immédiatement après. Le bâtiment L 414 est
la seule de mes nombreuses adresses que je n’ai jamais oubliée. J’avais eu de
la chance d’y être seulement admise, car on nous avait bien dit qu’il n’y avait
pas de place pour tout le monde.
Au départ, je voyais toutefois les choses un peu
différemment. Nous étions trente petites filles du même âge dans une pièce où
deux ou trois auraient pu séjourner agréablement. Et ce n’était pas une chambre,
c’était la pièce où nous habitions, l’unique. On y faisait aussi sa
Weitere Kostenlose Bücher