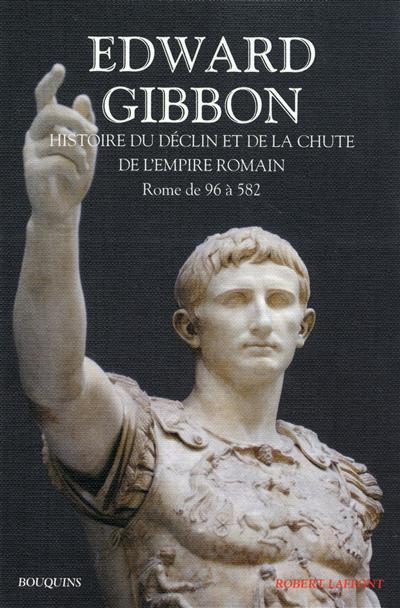![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
la Pouille, qui exerçait la petite fonction d’huissier priseur, coactor
exactionum . Voyez Horace, sat. I, v. 6, 86. D’ailleurs, quand le
poète fut fait tribun, Brutus, dont l’armée était composée presque entièrement
d’Orientaux, donnait ce titre à tous les Romains de quelque considération qui
se joignaient à lui. Les empereurs furent encore moins difficiles dans leurs
choix : le nombre des tribuns fut augmenté ; on en donnait le titre et les
honneurs à des gens qu’on voulait attacher à la cour. Auguste donna aux fils
des sénateurs tantôt le tribunat, tantôt le commandement d’un escadron. Claude
donna aux chevaliers qui entraient au service, d’abord le commandement d’une
cohorte d’auxiliaires, plus tard celui d’un escadron, et enfin, pour la
première fois, le tribunat ( Suétone, Vie de Claude , p. 25, et les notes
d’Ernesti). Les abus qui en provinrent donnèrent lieu à l’ordonnance d’Adrien
qui fixa l’âge auquel on pouvait obtenir cet honneur (Spartien, in Adr. ,
X). Cette ordonnance fut observée dans la-suite ; car l’empereur Valérien, dans
une lettre adressée à Mulvius-Gallicanus, préfet du prétoire s’excuse de
l’avoir violée en faveur du jeune Probus, depuis empereur, à qui il avait
conféré le tribunat de bonne heure, à cause de ses rares talents. Vopiscus, in
Prob. , IV. ( Note de l’Éditeur )
[67] Voyez la Tactique d’Arrien.
[68] Tel était en particulier l’État des Bataves. Tacite, Mœurs
des Germains , c. 29.
[69] Marc-Aurèle, après avoir vaincu les Quades et les
Marcomans, les obligea de lui fournir un corps de troupes considérable, qu’il
envoya. aussitôt en Bretagne. Dion, l. LXXI.
[70] Tacite, Annal. , IV, 5. Ceux qui composent ces
corps dans une proportion régulière d’un certain nombre de fantassins et de
deux fois autant de chevaux, confondent les auxiliaires des empereurs avec les
Italiens alliés de la république.
[71] Végèce, II, 2 ; Arrien, dans sa Description de la
marche et de la bataille contre les Alains .
[72] Le chevalier Folard (dans son Commentaire sur
Polybe , tome II, p 233-290) a traité des anciennes machines avec beaucoup
d’érudition et de sagacité : il les préfère même, à beaucoup d’égards, à nos
canons et à nos mortiers. Il faut observer que, chez les Romains, l’usage des
machines devint plus commun, à mesure que la valeur personnelle et les talents
militaires disparurent dans l’empire. Lorsqu’il ne fut plus possible de trouver
des hommes, il fallut bien y suppléer par des machines ; Voyez Végèce, II, 25,
et Arrien.
[73] Universa quæ in quoque belli genere necessaria
esse creduntur, secum legio debet ubique portare, ut in quovis loco fixerit
castra, armatam faciat civitatem . C’est par cette phrase remarquable que
Végèce termine son second livre et la description de la légion.
[74] Pour la castramétation des Romains, voyez Polybe, l.
IV ; avec Juste-Lipse, de Militiâ romanâ ; Josèphe, de Bello judaic. ,
l. III, c. 5 ; Végèce, I, 21-25, III, 9 ; et Mémoires de Guichard, tome I, c.
1.
[75] Cicéron, Tuscul. , II, 37 ; .Josèphe, de
Bello jud. , l. III, 5 ; Frontin, IV, 1.
[76] Végèce, I, 9 ; Voyez Mémoires de l’Académie des
Inscriptions , tome XXV, p. 187.
[77] Ces évolutions sont admirablement expliquées par M.
Guichard, nouveaux Mémoires , tome I, p. 141-234.
[78] Tacite ( Annal. , IV, 5) nous a donné un état
des légions sous Tibère, et Dion (l. LV, p. 794) sous Alexandre-Sévère. J’ai
tâché de m’arrêter à un juste milieu entre ce qu’ils nous apprennent de ces
deux périodes. Voyez aussi Juste-Lipse, de Magnitudine romanâ , l. I, c.
4, 5.
[79] Les Romains essayèrent de cacher leur ignorance et
leur terreur sous le voile d’un respect religieux. Voyez Tacite, Mœurs des
Germains , c. 34.
[80] Plutarque, Vie de Marc-Antoine ; et cependant,
si nous en croyons Orose, ces énormes citadelles ne s’élevaient pas de plus de
dix pieds au-dessus de l’eau, VI, 19.
[81] Voyez Juste-Lipse, de Magnitudine romanâ , l.
I, c. 5. Les seize derniers chapitres de Végèce ont rapport à la marine.
[82] Voltaire, Siècle de Louis XIV , c. 19. Il ne
faut cependant pas oublier que la France, se ressent encore de cet effort
extraordinaire.
[83] Voyez Strabon, l. II. Il est assez naturel de
supposer qu’Aragon vient de Tarraconensis : plusieurs auteurs modernes, qui ont
écrit en latin, se servent de ces deux mots comme synonymes ; il est
Weitere Kostenlose Bücher