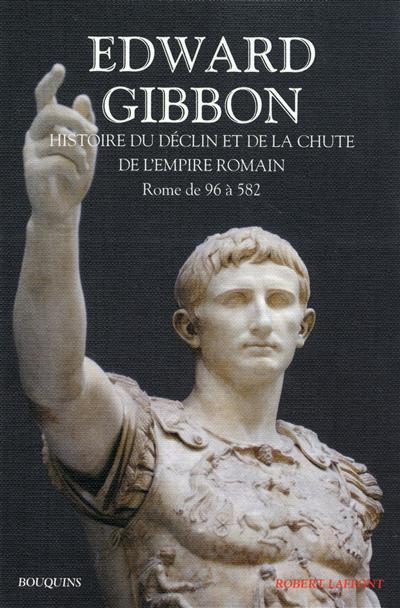![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
l’engagèrent à vivre ;
mais il paraît, autant du moins que le texte tronqué de Dion et l’abrégé
imparfait de Xiphilin nous mettent en état d’en juger, qu’elle conçut des
projets ambitieux, et tenta de s’élever à l’empire. Elle voulait marcher sur
les traces de Sémiramis et de Nitocris, dont la patrie était voisine de la
sienne. Macrin lui fit donner l’ordre de quitter sur le champ Antioche et de se
retirer où elle voudrait ; elle revint alors à son premier dessein, et se
laissa mourir de faim. Dion, LXXVIII, p. 1330 ( Note de l’Éditeur ).
[487] Dion, LXXVIII, p. 1330. L’abrégé de Xiphilin, quoique
moins rempli de particularité est ici plus clair que l’original.
[488] Il tenait ce nom de son bisaïeul maternel, Bassianus,
père de Julie-Mœsa, sa grand’mère, et de Julie-Domna , femme de Sévère. Victor
(dans l’ Épitomé ) est peut-être le seul historien qui ait donné la clef
de cette généalogie, en disant de Caracalla : Hic Bassianus ex avi
materni nomine dictus . Caracalla, Élagabal et Alexandre-Sévère portent
successivement ce nom ( Note de l’Éditeur ).
[489] Selon Lampride ( Hist. Auguste , p. 135 ),
Alexandre-Sévère vécut vingt-neuf ans trois mois et sept jours. Comme il fut
tué le 19 mars 235, il faut fixé sa naissance au 12 décembre 255. Il avait
alors treize ans, et son cousin environ dix-sept. Cette supputation convient
mieux à l’histoire de ces deux jeunes princes que celle d’Hérodien, qui les
fait de trois ans plus jeûnes (V, p. 181). D’un autre côté, cet auteur allonge
de d’eux années le règne d’Élagabal. On peut voir les détails de la
conspiration dans Dion, LXXVIII, p. 1339, et dans Hérodien, V, p. 184.
[490] En vertu d’une dangereuse proclamation du prétendu
Antonin, tout soldat qui apportait la tête de son officier pouvait hériter de
son bien et être revêtu de son grade militaire.
[491] Dion, LXXVIII, p. 1345 ; Hérodien, V, p. 186. La
bataille se donna le 7 juin 218, près du village d’Immæ, environ à vingt-deux
milles d’Antioche.
[492] Gannys n’était pas un eunuque. Dion, p. 1355 ( Note
de l’Éditeur ).
[493] Dion, LXXIX, p. 1350.
[494] Dion, LXXIX, p. 1363 ; Hérodien, V, p. 189.
[495] Ce nom vient de deux mots syriaques, ela , dieu ,
et gabal , former : le dieu formant ou plastique ;
dénomination juste et même heureuse pour le Soleil. Wotton, Histoire de Rome ,
p. 378.
Le nom d’Élagabale a été défiguré de plusieurs
manières : Hérodien l’appelle Ελαιαγαβαλος ; Lampride et les écrivains plus modernes en ont fait Héliogabale. Dion le
nomme Ελεγαβαλος ;
mais Élagabal est son véritable nom tel que le donnent les médailles. (Eckhel, de
Doct. num. vet. , t. VII, p. 250) . Quant à son étymologie, celle que
rapporte Gibbon est donnée par Bochart ( Chan. , II, c. 5) ; mais
Saumaise, avec plus de fondement ( Not. ad Lamprid., in Elagab .), tire ce
nom d’Élagabale de l’idole de ce dieu, représenté par Hérodien et dans les
médailles sous la figure d’une montagne ( gibel en hébreu) ou grosse
pierre taillée en pointe, avec des marques qui représentaient le Soleil. Comme
il n’était pas permis, à Hiérapolis en Syrie, de faire des statues du Soleil et
de la Lune, parce que, disait-on, ils sont eux-mêmes assez visibles, le Soleil
fut représenté à Émèse sous la figure d’une grosse pierre qui, à ce qu’il
parait, était tombée du ciel. Spanheim, Cœsar, Preuves, p. 46 ( Note de
l’Éditeur ).
[496] Hérodien, V, p. 190.
[497] Il força le sanctuaire de Vesta, et il emporta une
statue qu’il croyait être le Palladium ; mais les vestales se vantèrent
d’avoir, par une pieuse fraude, trompé le sacrilège en lui présentant une
fausse image de la déesse. Hist. Auguste , p. 103.
[498] Dion, LXXIX, p. 1360 ; Hérodien, V, p. 193. Les
sujets de l’empire furent obligés de faire de riches présents aux nouveaux
époux. Mammée, dans la suite, exigea des Romains tout ce qu’ils avaient promis
pendant la vie d’Élagabale.
[499] La découverte d’un nouveau mets était magnifiquement
récompensé ; mais s’il ne plaisait pas, l’inventeur était condamné à ne manger
que de son plat, jusqu’à ce qu’il en eût imaginé un autre qui flattât davantage
le goût de l’empereur. Hist. Auguste , p. 112.
[500] Il ne mangeait jamais de poisson que lorsqu’il se
trouvait à une grande distance de la mer : alors il en distribuait
Weitere Kostenlose Bücher