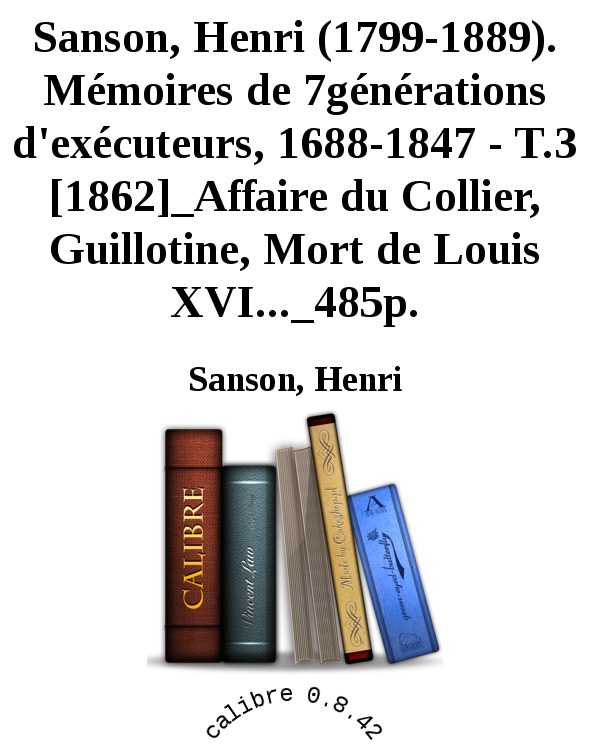![Mémoires de 7 générations d'exécuteurs]()
Mémoires de 7 générations d'exécuteurs
tout le fiel, qui, depuis cinq mois, s’amassait dans son cœur s’exhalait en reproches, en épithètes injurieuses, en imprécations ; en proie à une véritable frénésie, il déclara à son fils qu’il ne voulait plus dormir sous le même toit qu’un renégat, il lui ordonna de sortir à l’instant de sa demeure. Jean-Louis essaya encore de le fléchir en invoquant le souvenir de sa mère ; mais ne voyant que des velléités de résistance dans ses supplications, le vieux maréchal-ferrant prit son marteau et, le faisant tournoyer hors de sa tête, il jura avec un affreux serment qu’il allait lui fendre le crâne s’il s’obstinait à rester un instant dans la maison.
Des voisins et la servante qui étaient accourus aux cris de maître Louschart, entraînèrent Jean-Louis que son père continuait de maudire, bien qu’il ne pût l’entendre.
Jean-Louis ne pouvait se résigner à cette séparation. Pendant quelques jours il ne cessa d’errer autour du logis paternel, espérant toujours que son absence aurait apaisé le ressentiment du vieux maréchal, qu’il serait cruellement affecté par le vide qui devait exister autour de lui et que sa pensée se reporterait à celui qu’il avait banni pour le rappeler à ce foyer où sa place était marquée. La servante qui l’avait élevé et qui l’aimait, lui avait promis de parler pour lui ; elle le tenta : mais aux premiers mots qu’elle prononça, maitre Mathurin l’avait regardée de travers, et l’expression de sa physionomie avait fait comprendre à la brave femme que ce ne serait pas impunément qu’elle aurait plaidé la cause de l’absent. Aussi conseilla-t-elle au jeune homme de patienter et d’attendre.
Mais pour attendre il fallait vivre. Jean-Louis n’avait pas d’autres ressources que son travail ; il dut donc songer avant tout à se chercher un emploi.
L’injustice de son père l’avait rendu libre de ses actions ; il avait trop de répugnance pour la profession que la volonté de maître Mathurin lui avait imposée, pour la continuer désormais ; il chercha un état plus en rapport avec ses goûts et.son éducation première.
Il avait contracté quelques liaisons avec des clercs et des commis dont les manières et les habitudes tranchaient avec la grossièreté bruyante des compagnons ordinaires de ses travaux. Ces jeunes gens lui vinrent en aide ; l’un d’eux, employé chez M. Lecointre, le marchand de toile de la cour, parla à son patron de la singulière persécution que les principes démocratiques de Jean-Louis Louschart lui avaient value dans la maison de l’étrange aristocrate à tablier de cuir. M. Lecointre voulut voir le jeune homme, il fut frappé de sa distinction ; intéressé par la sensibilité avec laquelle il parlait de son malheur, il l’admit dans sa maison aux appointements de huit cents livres par an.
Mais M. Lecointre, malgré sa qualité de marchand de la cour, passait pour complètement acquis aux idées nouvelles. Cet abandon de l’état paternel, ce choix du patronage d’un révolutionnaire bien connu, n’étaient pas faits pour apaiser le courroux de maître Mathurin, ils constituèrent à ses yeux de nouveaux griefs qui mettaient le comble à ceux que déjà il se croyait ; ils confirmaient ses accusations, ils scellaient le jugement qu’il avait porté sur ce fils ingrat : ils les séparaient à jamais.
Il affecta alors de ne plus prononcer le nom de son fils et, s’il avait à s’informer sur sa situation personnelle, de se représenter comme affranchi de tous les liens, de toutes les obligations qu’imposent la paternité.
Bientôt il annonça à tous ses voisins qu’il allait se remarier, et le choix qu’il avait fait était un nouveau témoignage de la haine qu’il portait désormais à son fils.
IX - L’A UTO-DA-FÉ
suite
Depuis cinq années, une des cousines de maître Mathurin était venue demeurer dans sa maison.
Cette femme se nommait Elisabeth Verdier ; son mari avait été palefrenier à la grande écurie ; elle avait été employée à la lingerie du château. L’homme était mort, et la faiblesse de la vue de la veuve l’avait contrainte de renoncer à son modeste emploi. Touchées de ce qu’on leur avait raconté de la situation de cette femme, Mesdames, tantes du Roi, lui avaient accordé une pension de deux cents livres, mais Elisabeth Verdier avait une fille et cette pension était insuffisante pour subvenir aux besoins de deux
Weitere Kostenlose Bücher