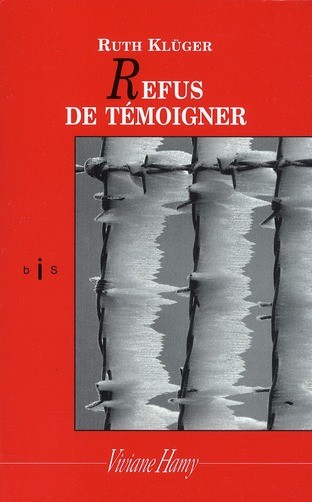![Refus de témoigner]()
Refus de témoigner
particulier, qui précisément n’a pas été condamné à y mourir, mais
l’aurait été, s’il n’avait pas pu émigrer. Je comprends bien son essai, car il
porte justement sur ma question de savoir si l’on peut ou non envoyer les fantômes
au musée. Peter Weiss traîna avec lui ses propres fantômes, du procès d’Auschwitz,
à Francfort, jusqu’en Pologne. Dans un premier temps il répond « non »
à cette question, on ne le peut pas, car le camp qu’il voit est vide des événements
passés, ce n’est pas mon camp, mais bien plutôt celui où les deux jeunes et braves
Allemands repeignent la barrière en blanc, pour entretenir les installations. Mais
il y a une autre réponse, un « oui » de dernière minute, à la
dernière page, car ce visiteur d’Auschwitz réussit à invoquer les esprits dans
un ancien baraquement. C’est le point décisif : dans la nouvelle
constellation du lieu, régie par le rapport entre le monument historique et son
visiteur, Peter Weiss vit ce qu’il a apporté avec lui. Or qu’est-ce qui
pourrait être plus éloigné de cette constellation que le rapport entre prison
et détenu ?
Et pourtant Weiss était le visiteur le plus parfait que l’on
pût imaginer, car il ne contemple pas un monument achevé, immuable. Il termine
en notant que « ce » n’est pas fini, et ce faisant, avec la logique
systématique qui lui est propre, il compare la persécution des Juifs à d’autres
crimes collectifs, ce que beaucoup lui ont amèrement reproché. Je ne vois
pourtant pas comment on pourrait appréhender la chose autrement que par des
comparaisons.
Claude Lanzmann sur les traces des camps demande aux
autochtones dans son terrible film Shoah : « C’était à trois
pas, sur la droite ou sur la gauche ? Là ou là-bas ? Les arbres
étaient déjà là ? » Un obsédé, me dis-je, spectatrice dans la salle
obscure, partagée entre l’admiration et le sentiment d’être en avance sur lui :
« Il te faut les lieux. Moi, les noms me suffisent » ; et je
reste pourtant captivée par son obsession.
Cette culture de musée repose sur une superstition profonde,
l’idée qu’on saisirait les fantômes précisément sur les lieux où ils ont cessé
d’être des vivants. Ou bien plutôt non pas une superstition profonde, mais
superficielle, telle qu’en suscitent toutes les maisons hantées du monde. Le
visiteur qui se retrouve là et qui éprouve une émotion, ne fût-ce que ce léger
frisson d’horreur, se sentira quand même un homme meilleur. Qui se permet de s’interroger
sur la qualité des sentiments, quand on est fier d’éprouver seulement quelque
chose ? Ces vestiges rénovés de terreurs anciennes n’induisent-ils pas au
sentimentalisme, ne nous éloignent-ils pas en réalité de l’objet sur lequel ils
n’ont attiré l’attention qu’en apparence, pour nous entraîner à contempler nos
sentiments dans un miroir ?
D’un autre côté : une psychiatre allemande de mon âge
me raconte qu’étant enfant, juste après la guerre, elle a réuni un groupe d’enfants
de son âge et organisé une excursion au camp de concentration voisin, Flossenbürg.
Il n’y avait plus personne, mais il restait des traces des détenus, objets
rouillés, lambeaux de vêtements, et les baraquements. Plus personne n’était
venu en ce lieu rapidement abandonné après la libération. Mon amie dit que là, on
percevait encore le souffle de la shoah, et que ce n’était pas une
atmosphère de musée. Des années plus tard, ce sont les professeurs eux-mêmes qui
conduisaient ces groupes en essayant de dicter aux élèves leurs réactions. Tout
était encore tout frais, le sang avait été irrévocablement versé, mais, si l’on
peut dire, n’avait pas encore coagulé. J’imagine ces enfants qui, la bouche
ouverte, avec un petit gloussement d’embarras, ramassent une cuillère de plomb,
tâtent la paillasse, avec le sentiment délicieusement coupable de jouer en
cachette un bon tour aux adultes, de jeter un coup d’œil derrière leurs rideaux,
enfin de faire une chose interdite, à l’initiative ou par la faute d’une
camarade effrontée.
Pour moi, le camp de Flossenbürg, que je ne connais pas, occupe
une place unique, car j’ai failli y être transportée, et ça aurait été mon
quatrième camp. Je ne l’ai compris que des décennies plus tard, quand j’ai
commencé à lire des ouvrages sur les camps, car longtemps je ne m’y suis
absolument pas
Weitere Kostenlose Bücher