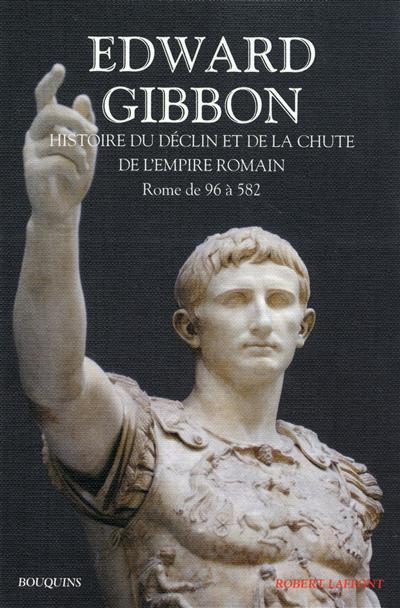![Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain]()
Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain
persécuteur des
chrétiens. L’évêque d’Éphèse, le clergé, les magistrats, le peuple et
l’empereur Théodose lui-même, à ce que l’on assure, s’empressèrent de visiter
la caverne merveilleuse des sept dormants, qui donnèrent leur bénédiction,
racontèrent leur histoire, et expirèrent tranquillement aussitôt après. On ne
peut attribuer l’origine de cette fable à la fraude pieuse ou à la crédulité
des Grecs modernes ; puisqu’on peut retrouver les traces authentiques de la
tradition de ce miracle supposé jusqu’à environ un demi-siècle après
l’événement. Jacques de Sarug, évêque de Syrie, né deux ans après la mort de
Théodose le jeune, a consacré à l’éloge des dormants d’Éphèse [3856] une des deux
cent trente homélies qu’il a composées avant la fin du sixième siècle. Leur
légende fut traduite du syriaque en latin par les soins de saint Grégoire de
Tours. Les communions opposées de l’Orient en conservent la mémoire avec la
même vénération, et les noms des dormants sont honorablement inscrits dans les
calendriers des Romains, des Russes [3857] et des Abyssins. Leur renommée a passé les limites dlu monde chrétien. Mahomet
a placé dans le Koran, comme une révélation divine, ce conte populaire, qu’il
apprit sans doute en conduisant ses chameaux à la foire de Syrie [3858] . L’histoire des
sept dormants d’Éphèse a été adoptée et embellie depuis le Bengale jusqu’à
l’Afrique, par toutes les nations qui professent la religion de Mahomet [3859] , et l’on
découvre quelques vestiges d’une tradition semblable dans les extrémités les
plus reculées de la Scandinavie [3860] .
On peut attribuer la crédulité générale au mérite ingénieux de cette fable en
elle-même ; nous avançons insensiblement de l’enfance à la vieillesse sans
observer le changement successif, mais continuel, de toutes les choses humaines
; et même dans le tableau plus vaste que nous présente la connaissance de
l’histoire, l’imagination s’accoutume, par une suite perpétuelle de causes et
d’effets, à réunir les révolutions les plus éloignées ; mais si l’on pouvait
anéantir en un moment l’intervalle de deux époques mémorables, s’il était
possible d’exposer la scène du monde nouveau aux yeux d’un spectateur qui,
après un sommeil de deux cents ans, conserverait l’impression vive de
l’ancienne époque où il a commencé, sa surprise et ses réflexions fourniraient
le sujet intéressant d’un roman philosophique. On ne pouvait pas placer cette
scène plus avantageusement qu’entre les deux siècles qui s’écoulèrent du règne
de Dèce à celui de Théodose le jeune. C’était entre ces deux époques que le
siège du gouvernement avait été transporté de Rome dans une ville nouvelle sur
les rives du Bosphore de Thrace ; et l’abus de l’esprit militaire avait
disparu, devant un système factice d’obéissance cérémonieuse et servile. Le
trône de Dèce, persécuteur des chrétiens, était occupé depuis longtemps par une
succession de princes orthodoxes qui avaient anéanti les divinités fabuleuses
de l’antiquité ; et la dévotion publique s’empressait à élever les saints et
les martyrs de l’Église catholique sur les autels de Diane et d’Hercule.
L’union de l’empire romain n’existait plus ; son antique majesté rampait dans
la poussière ; et des essaims de Barbares inconnus, sortis des régions glacées
du Nord, avaient établi victorieusement leur empire dans les plus belles
provinces de l’Europe et de l’Afrique.
CHAPITRE XXXIV
Caractère, conquête et cour d’Attila, roi des Huns. Mort, de Théodose le jeune.
Élévation de Marcien sur le trône de l’Orient.
LES Goths et les Vandales, chassés par les Huns, pesaient
sur l’empire d’Occident ; mais les Huns vainqueurs ne s’étaient pas distingués
par des exploits dignes de leur puissance et de leurs premiers succès. Leurs
hordes victorieuses couvraient le pays situé entre le Danube et le Volga ; mais
les forces de la nation, épuisées par les discordes des chefs indépendants les
uns des autres, dont la valeur se consumait sans utilité en d’obscures
excursions, n’avaient d’autre but que le pillage ; et, à la honte de la nation,
l’espoir du butin les faisait souvent passer sous les drapeaux des ennemis
qu’ils avaient vaincus. Sous le règne d’Attila [3861] , les Huns
redevinrent la terreur de l’univers. Je vais
Weitere Kostenlose Bücher